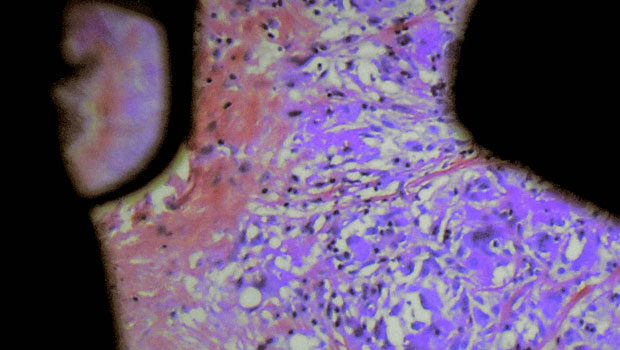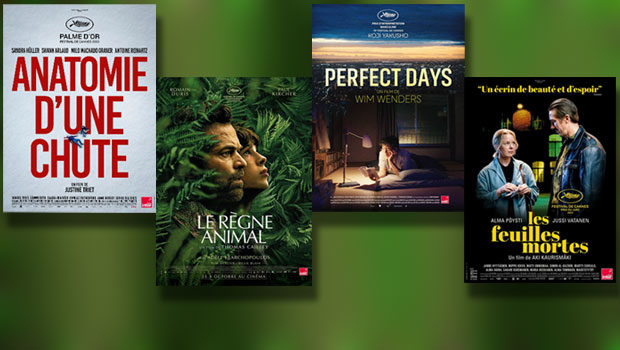Photographier la douleur
L'exposition Un monde à guérir aux Rencontres de la photographie d’Arles
Jusqu’au 25 septembre, les Rencontres de la Photographie d’Arles proposent comme chaque année une riche sélection d’expositions photographiques. Plusieurs d’entre elles méritent le détour, mais une exposition en particulier offre matière à réfléchir sur une certaine histoire de la photo, celle des reportages humanitaires.
Que montre une photographie qu’un documentaire ne pourrait pas filmer ? La question revient bien sûr souvent, et aux Rencontres de la Photographie d’Arles en particulier. Cette année, une exposition interroge cette question davantage que les autres. Un monde à guérir retrace en effet 160 ans d’histoire photographique du mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. 160 ans de guerres et de catastrophes naturelles, de conflits mondiaux et de crises oubliées, illustrées par les photographies d’artistes de renom – les talents de l’agence Magnum comme Robert Capa ou Henri Cartier-Bresson – ou de photographes amateurs, souvent anonymes, les humanitaires eux-mêmes.
Comme une peinture
Ce qui frappe, d’abord, c’est la composition de ces photographies. Souvent, elles semblent rappeler des œuvres picturales très connues : ici, la photo d’une femme, de dos, observant en contrebas depuis un monticule de pierres un site de distribution de nourriture au Soudan en 2006, évoque immédiatement le fameux Voyageur contemplant une mer de nuages de Caspar David Friedrich (1818). Là, les étreintes de deux frères après une longue séparation, leurs visages cachés par un chapeau de prière blanc, rappelle le baiser des Amants de Magritte (1928). Même une ancienne photo d’exercice antigaz dans les années 1930 semble composée comme le Déjeuner sur l’herbe de Manet (1863). Il y a donc dans ces photographies, contrairement à un reportage télévisé d’information, la volonté première de produire une œuvre esthétique. C’est, bien sûr, le propre de la photo d’art, mais cela peut sembler ici plus surprenant puisqu’il s’agit de documents produits pour alerter le monde sur les malheurs d’ailleurs. Évidemment, cet esthétisme n’est pas gratuit : il a pour objectif de sensibiliser, d’émouvoir. Pour rappeler que la souffrance est universelle, que la détresse d’un Africain vaut bien celle d’un Européen ou d’un Américain. Or, pour que ces photographies paraissent d’emblée émouvantes, il faut passer par le prisme de codes inconscients, d’une culture commune aux Occidentaux, en citant notamment des tableaux de maître. L’effet est assuré : les photographies attirent l’œil et émeuvent. Mais le procédé a ses limites. Universel, le malheur devient interchangeable. On oublie le contexte, les raisons qui ont amené ces souffrances. S’il n’y avait pas les cartels explicatifs et le titre des œuvres, situant les photographies dans le temps et l’espace, impossible de comprendre ce que l’on a en face des yeux. À peine aurait-on pu distinguer l’Afrique du sous-continent indien, les années 1980 ou la guerre de 14 (à moins qu’il ne s’agisse de celle de 1870 ?). Ce que la photographie gagne en émotion, elle le perd en colère. Sans connaissance du contexte, on est ému par cette photo de jeunes enfants au Malawi, et puis, on passe à la suivante. Censées décrire l’ « urgence humanitaire », ces photographies ont au contraire normalisé la situation de pauvreté, de famine ou de violence dans ces pays dit « pauvres ».
Leurs photos
Mais c’est à la fin de l’exposition que se trouve l’ensemble d’œuvres le plus surprenant. Collectées par le photographe Alexis Cordesse, on y découvre une série de photographies personnelles de Syriens ayant fui leur pays. Photos de famille, de vacances, de fêtes et de moments joyeux, elles montrent une vie heureuse, que l’on suppose avant la guerre. Une vie finalement peu différente de la nôtre, en Europe. À nouveau, on est émus par ces photographies, car on y reconnaît des codes et une culture qui nous sont familiers. Cependant, cette émotion est plus forte que celle des photographies précédentes, car elle n’est pas due au regard d’un photographe européen, mais à celui du futur réfugié lui-même. En ouvrant la porte de son intimité, Alexis Cordesse l’humanise davantage que si on le voyait sur un Zodiac chavirant façon Radeau de la méduse. Enfin, c’est parce qu’on connaît le contexte ultérieur de ces photographies, la guerre civile syrienne, les destructions et les exodes longuement documentés par la presse, la télévision et le cinéma que ces photos nous rendent particulièrement tristes, et mélancoliques. En effet, on a vu des films sur le sujet, certains nous offrant même l’expérience du point de vue de victimes du conflit, avec notamment le fameux documentaire de Waad al-Kateab, Pour Sama (2019), où la jeune femme filmait son quotidien et la naissance de sa fille pendant le siège d’Alep. Mais avec ce travail d’archives photographiques, Alexis Cordesse va plus loin encore. Les photos le prouvent, ces instants de bonheur sont incontestables, ils ont bien eu lieu. Et, en même temps, ce ne sont que des instants figés et sélectionnés. On ne sait pas ce qu’il s’est passé avant ou après, ce que ces gens se sont dit. Ce qui nous permet à la fois de projeter un peu de nous-mêmes, et d’être ainsi saisis par ces destins dans lesquels on peut se reconnaître, tout en sachant pertinemment qu’ils sont pris dans un contexte géographique et historique particulier, différent du nôtre. Si l’objectif est de sensibiliser, difficile donc de faire mieux, puisqu’on prend conscience immédiatement de la réalité de ces guerres, de ces catastrophes, de cette souffrance, que jusque-là, en dépit de la quantité d’images qui existent et dont on est sans cesse abreuvé, on avait préféré oublier.