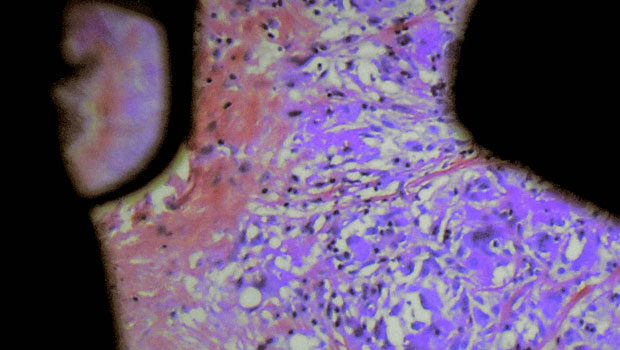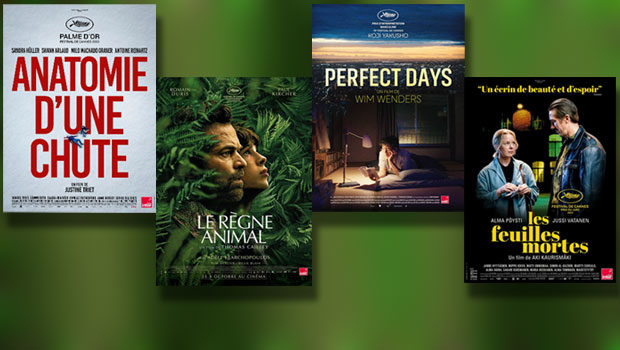Elle est belle, drôle et sexy. Elle a un redoutable sens du tempo et le rire le plus communicatif de la planète. Même quand elle est mauvaise, elle est bonne. Mais pourquoi Julia Roberts est-elle si Julia Roberts ?
Dans Un été à Osage County de John Wells, elle tient tête à la grande Meryl Streep qui interprète sa génitrice. Elle s’engueule et se bat férocement avec elle lors de scènes mémorables (qui valent aux deux actrices d’être nommées aux Oscars). Son personnage, en dehors de ces moments forts, a ses moments « faibles ». Moins spectaculaires, mais tout aussi remarquables. Barbara, l’aînée des Weston a pris un grand coup sur la tête : son mariage part à la dérive, son père vient de mourir, et sa mère est une mégère. Bienvenue dans l’enfer de la famille ! Regard perdu dans le lointain des plaines de l’Oklahoma, dents serrées face au flot de paroles venimeuses déversées en plein repas, fragilité crispée lorsqu’elle implore sa fille de quatorze ans de mourir après elle… De cette partition — chargée— pour famille désaccordée, Julia Roberts émerge, douloureuse et limpide. Sans fard. Des fils d’argent courent dans sa chevelure châtain, de petites rides s’accrochent au coin de ses yeux, elle porte un vaste T-shirt marron ou une robe-sac noire. Ses scènes en creux sont les plus puissantes : preuve que l’actrice qui s’était égarée dans des comédies mollassonnes ces derniers temps n’a rien perdu de son talent.
Pourquoi elle ne sera jamais fausse
Depuis ses débuts, sur son front, deux veines, une grande et une plus petite, apparaissent formant un v. Lorsqu’elle rit, lorsqu’elle crie, lorsqu’elle est émue. Souvent, donc. Et cette manifestation incontrôlable est belle à voir. Comme le signe que derrière le savoir-faire indéniable de l’actrice, son sens du rythme et du tempo, derrière le maquillage parfait de son visage admirable, il y a plus. Il y a le sang qui pulse, l’énergie de la vie. Son rire vient du même endroit. Éclat, fracas, cascade incoercible du grave à l’aigu (et retour). Ce rire est un bonheur communicatif. Dans Pretty Woman, lorsqu’elle vient de négocier sa présence tarifée dans la vie de Richard Gere, balançant un tonitruant « Holly shit ! » et plongeant dans la mousse de la baignoire, quand elle danse avec Rupert Everett à la fin du Mariage de mon meilleur ami, ou reçoit un Oscar pour Erin Brockovich, voix tremblante et hurlement de rire « I love the world ! ». Le monde le lui rend bien.
Vivante, vibrante, ravissante. Dès Mystic Pizza (Donald Petrie, 1988), on sent chez elle une générosité non feinte, une capacité à tout donner si la cause est juste. Son large sourire n’est pas que dents blanches et lèvres pulpeuses, car lorsque sa bouche s’étire, ses yeux bruns pailletés s’allument et c’est tout son corps qui sourit. Ce long corps sublime d’1,74 m qu’elle trimballe bizarrement. Si elle n’est pas chaussée de ballerines, Julia Roberts se déplace gauchement, pingouin dégingandé et malhabile. Ça fait d’elle une princesse déchue, une femme avec faille.
Pourquoi elle ne sera jamais banale
Le clown en elle la sauvera toujours. De toutes les situations. Fussent-elles aussi embarrassantes que la terrible choucroute blonde de milliardaire texane dont elle est affublée dans La Guerre selon Charlie Wilson de Mike Nichols (2007) ; ou la guimauve à la sauce mélasse qui tient lieu de scénario à Mange, prie, aime de Ryan Murphy (2010). Méchante Reine dans Blanche Neige de Tarsem Singh (2012), elle se tire admirablement du grand n’importe quoi foutraque et rigolo qu’est le film : elle rit de se voir si belle en ce miroir et s’amuse de son image, elle joue à fond la carte du too much. Reine, elle est. Et « girl next door », aussi. Le succès planétaire de Pretty Woman de Garry Marshall, en 1990, la propulsa au firmament. Elle avait 23 ans. Comment résister ? En essayant tous les styles, polar, mélo, drame. En tournant avec les plus grands : Steven Spielberg, Robert Altman, Woody Allen, Stephen Frears, Steven Soderbergh… Ce dernier lui a offert, avec Erin Brockovich, seule contre tous, le rôle qui devait effacer définitivement le rictus d’incrédulité du visage de ses derniers détracteurs. Seulement douée pour les comédies romantiques, Julia ? Certes, ses trois plus belles performances d’alors étaient liées à ce genre, hollywoodien en diable : Pretty Woman (1990), Le Mariage de mon meilleur ami (1997) et Coup de foudre à Notting Hill (1999). Dans ces films, les nuances du personnage qu’elle interprète sont multiples, le prisme est large, la gamme infinie. Comme dans Erin Brokovich : elle y est à la fois une mère de famille sans le sou, une amoureuse déçue, une bosseuse infatigable, une emmerdeuse patentée, une citoyenne concernée.
Le monolithique ne lui convient guère, c’est la raison pour laquelle Mary Reilly de Stephen Frears est une demi-réussite : sur un seul ton, Julia Roberts n’existe pas assez. Il lui faut du polysémique, du polyvalent, du polychrome.
Pourquoi elle sera toujours une star
Parce que ! Ça ne s’explique pas. C’est chimique et organique, évident et mystérieux. Elle est tellement star qu’elle peut jouer une star à l’écran sans que ce statut soit remis une seconde en question.
Dans The Player de Robert Altman (1992). Dans Full Frontal de Steven Soderbergh (2002). Et, toujours chez Soderbergh dans Ocean’s Twelve (2004), elle joue Tess, qui se fait passer pour Julia Roberts après un bref débriefing : « Tu es née à Smyrne, Géorgie, en 1967, ton deuxième prénom est Fiona… »Mais c’est Coup de foudre à Notting Hill de Roger Michell (1999) qui va le plus loin dans la mise en abyme. Will (Hugh Grant), petit libraire londonien, rencontre LA star américaine, Anna Scott. Lors de la formidable scène où tous les amis de Will font le bilan de leur vie et doivent prouver, pour remporter la dernière part de brownie, qu’ils ont tout raté, Anna Scott, présumée hors concours, demande à tenter sa chance. Elle égrène ses aventures amoureuses malheureuses, le régime draconien qu’elle s’impose depuis dix ans, les opérations chirurgicales, et conclut : « Et un jour, un jour pas si lointain, ma beauté envolée, tout le monde va s’apercevoir que je ne sais pas jouer la comédie. Je deviendrai cette femme mûre et aigrie qui ressemble vaguement à quelqu’un qui fut célèbre à une époque. » Julia, ou Anna… qui parle ?
Pourquoi elle sera toujours Julia
« Il serait temps que le piano réalise qu’il n’a pas écrit le concerto », entendait-on dans Eve de Joseph L. Mankiewicz. Julia Roberts le sait. Pertinemment. Interprète, elle a besoin d’un personnage bien dessiné, d’un texte ciselé. Et plus le dialogue est joliment écrit, mieux il sort de sa jolie bouche. Ce qui ne l’empêche pas (pour la véracité d’un personnage, bien sûr) de lâcher des gros mots à faire pâlir toutes les ligues de vertu. L’harmonie à laquelle elle est arrivée en un peu plus de vingt-cinq ans et une quarantaine de films, est le reflet d’une personnalité passionnante. D’elle, on sait le minimum (« Née à Smyrne en Georgie, son deuxième prénom est Fiona… »), mais à l’écran, elle est au maximum. La persona Julia telle que projetée à nos yeux est une inconnue célèbre, simple et multiple, un éternel recommencement. Juste une fille. Une fille juste.