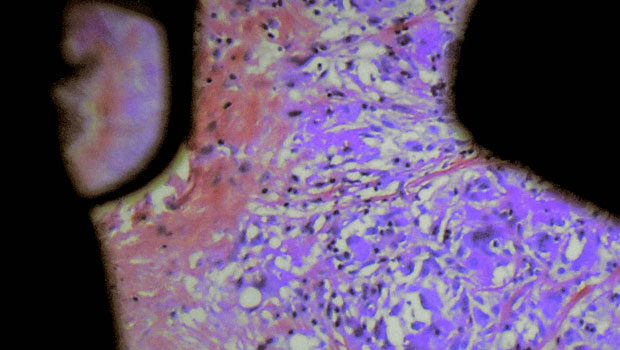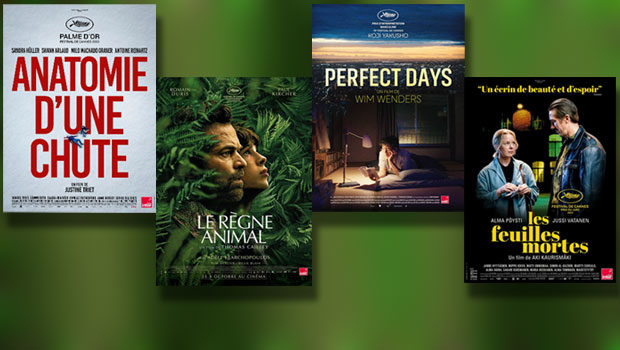It Must Be Heaven
Elia Suleiman fuit la Palestine à la recherche d’une nouvelle terre d’accueil, avant de réaliser que son pays d’origine le suit toujours comme une ombre. La promesse d’une vie nouvelle se transforme vite en comédie de l’absurde. Aussi loin qu’il voyage, de Paris à New York, quelque chose lui rappelle sa patrie.
Un conte burlesque explorant l’identité, la nationalité et l’appartenance, dans lequel Elia Suleiman pose une question fondamentale : où peut-on se sentir « chez soi » ?
It Must Be Heaven est une jolie parenthèse poétique d’Elia Suleiman sur l’identité palestinienne en compétition à Cannes. Le cinéaste y incarne un voyageur, doux et quasi muet, qui se balade de ville en ville – Paris, New-York, Nazareth – , observateur de l’impact de sa nationalité sur les autres, du climat, de petits détails et des gens dans les rues et jardins. Avec son apparence de Woody Allen désœuvré, il est souvent drôle face aux différents passants, jeunes, vieux, mannequins ou policiers, toujours décrits dans différentes situations cocasses. On pense beaucoup à la tendresse et l’expression cinématographique de Jacques Tati, où les sons et les dialogues sont à peine perceptibles, mais l’objet d’amusements répétés et sensibles. On gardera longtemps en mémoire cette séquence hilarante, suave et innocente du cinéaste contrarié par un petit moineau qui l’empêche d’écrire sur son clavier d’ordinateur. Ce n’est certes pas grand-chose, mais dans un monde brutal et violent, ces images joyeuses et délicates font l’effet d’une bulle de savon, légère, portée par la brise et qui, lorsqu’elle disparaît sans le moindre bruit, laisse un souvenir d’élégance. Délicieux et rafraîchissant.