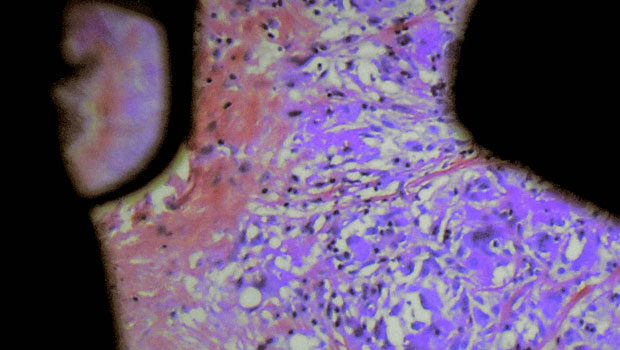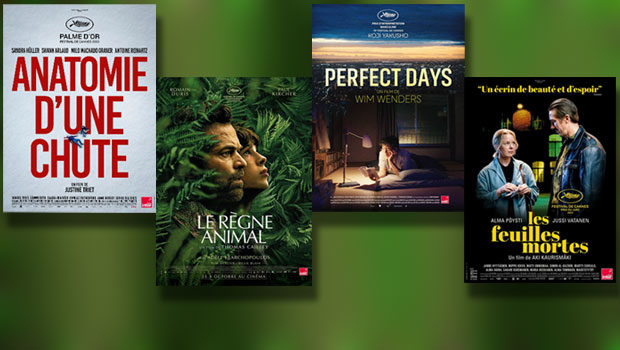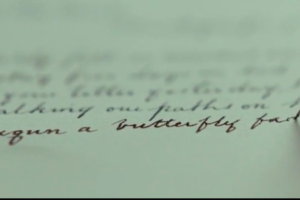
Sorti en 1949, situé entre Antoine et Antoinette et Édouard et Caroline, Rendez-vous de juillet constitue le deuxième volet d’une trilogie officieuse interrogeant la notion de couple dans le contexte de la crise d’après-guerre. Jovial et lumineux, le film occupe une place à part dans l’œuvre de Jacques Becker, tant il exprime la volonté de son réalisateur d’avancer avec volontarisme vers une gaieté tout juste retrouvée, semblant enfin possible, quatre ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale. Si le premier titre se caractérisait par une tonalité plus sombre, suivant la recherche désespérée d’un billet de loterie perdu par un ouvrier, cette balade insouciante se savoure encore aujourd’hui, près de soixante-dix ans après son tournage, comme une profession de foi et d’enthousiasme de Becker envers sa génération, à laquelle il s’identifie avec passion. En témoigne l’un des héros, incarné par le jeune Maurice Ronet, frais émoulu de l’ancienne IDHEC, affirmant, fataliste : « Aujourd’hui on ne fait plus de films en France ». Qu’à cela ne tienne, Becker en fait un pour conjurer le sort ! Ce qui rend heureux dans ce film, c’est la sensation toujours renouvelée que Jacques Becker l’a réalisé avec la même générosité qui consiste à laisser sa porte ouverte à un ami. Une porte sans verrous ni clé pour pouvoir la traverser, et débouler de plain-pied dans un temps et un monde que l’on croyait inconnu. Celui de nos grands-parents, que l’on découvre soudain danseurs voltigeurs dans les caves surchauffées de Saint-Germain-des-Prés, vibrant de la même sève et des mêmes désirs charnels que leurs petits-enfants d’aujourd’hui. Filmé sur les lieux mêmes de l’action, dans les rues ensoleillées du Paris de l’époque, la caméra de Becker capte le jeu d’une modernité inattendue de ses acteurs, très loin des voix caquetantes de type ORTF, avec une légèreté saisissante, qui donne l’impression, malgré le noir et blanc et le bouquet d’accents parigots surannés, de voir un document contemporain, qui anticipe de presque dix ans la Nouvelle Vague. La modernité de ce film miraculeux tient dans le contraste entre sa totale simplicité de fabrication et son efficacité narrative. Rendez-vous de juillet est un film buissonnier, joyeux et solaire comme une après-midi volée, mais également un film rageur, qui cherche à faire imploser les carcans d’une société bourgeoise moribonde, trop vite revenue à ses petites habitudes mortifères d’avant-guerre. La séquence inaugurale annonce d’emblée ce programme de rupture, lorsqu’un repas en famille est subitement interrompu par le départ du héros, en réaction aux rigides injonctions de son père. Le personnage de Daniel Gélin fuit de la sorte les schémas sociaux préétablis, et claque symboliquement la porte du cinéma de papa, non sans avoir laissé entrer un courant d’air vespéral dans la pièce. Bien avant Nuit Debout, voilà donc un film qui affirmait bien fort, avec un large sourire et au rythme d’un jazz surpuissant et syncopé, qu’il fallait faire autrement que les aînés, sinon, ça ne marcherait pas. Mais cette rupture va de pair avec une bienveillance de chaque instant, marque d’un humanisme profond et sincère, illustrant un passage de témoin entre générations à l’aide de dialogues gorgés de bonté et d’espérance. Ainsi, lorsqu’un vieux directeur du Musée de l’Homme, obligé de refuser une aide financière à un jeune explorateur tentant de monter une expédition, le salue d’un « Bon courage ! », la belle réponse lancée par Daniel Gélin résume toute la détermination du film : « J’en ai ».