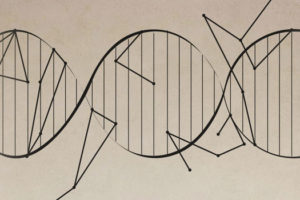Lenny Borger, traduire pour mieux aimer
« Un film est comme un roman, il faut le traduire à chaque nouvelle génération » Lenny Borger
Lorsque Lenny Borger débarque à Paris au milieu des années 1970, ce jeune New-Yorkais de Brooklyn porte déjà en lui l’amour de la langue française, une langue étrangère qui sonne à ses oreilles de jeune adolescent alors qu’il découvre, quasi en direct, l’excellence de la chanson française, de Jean Ferrat à Jacques Brel.
Que fait un Américain à Paris lorsqu’il aime le cinéma ? Outre de fréquenter la Cinémathèque française et les salles obscures, Lenny devient critique pour le journal américain de référence, Variety, poste qu’il occupera jusqu’au début des années 1990.
En 1980, Bertrand Tavernier lui propose de faire le sous-titrage de son film Une semaine de vacances avec Nathalie Baye et Gérard Lanvin. C’est le début d’une longue carrière, au cours de laquelle Lenny Borger traduira dans la langue de Shakespeare plus d’une centaine de films français, avec une prédilection pour le cinéma de l’entre-deux-guerres. Marcel Carné, Jean Renoir, Julien Duvivier, Henri-Georges Clouzot, Robert Bresson, Georges Franju, Luis Buñuel, mais aussi Jean-Pierre Melville, Claude Chabrol, Jean-Luc Godard, Claude Sautet, Patrick Chéreau, parmi tant d’autres. Nous recevant chez lui, dans son appartement parisien mitoyen du Grand Rex, Lenny égrène quelques souvenirs de son travail des mots au service du cinéma.
Dans les années 2000, Criterion m’avait demandé de traduire la période classique de Jean-Luc Godard, les films des années 1960. À bout de Souffle était un bijou pour tout traducteur, c’est un film qui comporte énormément de jeux de mots, certains très marrants. J’avais d’ailleurs trouvé une astuce linguistique en anglais pour la phrase : « T’es vraiment dégueulasse » / « You make me puke ». Quand j’ai fait ce travail de traduction, j’avais regardé ce qui avait été fait avant. Il faut préciser que tout n’était pas vraiment bien traduit, c’était bien plus succinct, on ne cherchait pas vraiment à transmettre la saveur du dialogue, ça restait tout de même assez littéral.
La dernière réplique d’Anna Karina m’a donné beaucoup de mal. Jean Claude Brialy et Anna Karina sont ensemble au lit, il lui dit : « Angela, tu es infâme », elle lui répond : « Moi ? Je ne suis pas infâme, je suis une femme ». J’ai trouvé l’équivalent en anglais avec : il lui dit « Damn you, Angela ! » Elle réplique : « No, a dame me ». J’étais seul à faire ce travail, à l’occasion de la ressortie du film en Amérique. C’était au studio Malakoff ; je me souviens que la sœur de Jean-Luc Godard était présente au labo lorsque j’ai fait cette dernière phrase, je lui avais demandé de venir, car j’avais des problèmes de traduction. Bien plus tard, Anne-Marie Miéville, avec qui j’ai eu l’occasion de travailler sur ses films, me recommande à nouveau pour travailler avec lui sur Éloge de l’amour. Avec ma collègue Cynthia Schoch, nous avons traduit ce film, c’est un objet très curieux. Ça s’est passé parfaitement bien. Il nous avait invités à découvrir le film chez lui en Suisse. Je me souviens, j’étais un peu grincheux, je ne voulais pas me déplacer aussi loin pour un travail que je ferais de toute façon en région parisienne. On a tout de même pris le train jusqu’à Lausanne, et ensuite un bus pour Rolle. Il nous a vraiment bien reçus, il était très sympathique, comme Anne-Marie Miéville. C’était une expérience assez drôle. Le lendemain de la première à Cannes en mai 2001, il m’a appelé pour me dire combien il était content des sous-titres. J’aurais dû, je pense, arrêter là, car après ce fut un peu plus compliqué. Avec Notre musique, tout devenait un peu plus complexe, il y avait plusieurs langues à traduire. Mais surtout, il ne voulait pas que tout soit traduit. Je me souviens plus particulièrement d’un poème arabe de Mahmoud Darwish. Elias Sanbar était présent pour le sous-titrage du film, c’était sa traduction en français que j’avais entre les mains, mais Jean-Luc Godard refusait que je traduise ce poème. Il me disait, de manière très polie : « Non, pas besoin de traduire ça. » Aujourd’hui, le public attend que tout soit vraiment traduit dans le sous-titrage. Nous lui avons fait une traduction très littérale, et il l’a prise pour en faire des sous-titres bien plus brefs. Il sait ce qu’il veut, lui et moi nous parlions en français, et je savais fort bien qu’il maîtrisait l’anglais. Je dois ajouter que je n’étais pas vraiment d’accord avec son choix. Je ne dirais pas qu’il avait tort, mais c’est comme si, pour ce film, on n’avait pas le droit de savoir ce qui se disait, comme si nous ne devions pas comprendre. Tout en comprenant que c’était un parti pris esthétique, je demeurais néanmoins assez dubitatif… J’ajoute tout de même que c’est toujours mieux que le cinéaste soit présent à cette étape du travail, même s’il ne comprend pas tout à fait l’anglais, il sent si quelque chose ne va pas. Le cinéma de Bertrand Tavernier est très écrit, raison pour laquelle il était toujours présent durant ce travail des sous-titrages. Pour son film L627, ne serait-ce que pour les finitions, nous avons passé plus de quinze heures, il y avait pas mal d’argot dans le parler des policiers notamment.
Oui, notamment ceux de la période de l’entre-deux-guerres, un cinéma que j’aime particulièrement pour la saveur de la langue. Julien Duvivier est un cinéaste que je connais et apprécie beaucoup, j’ai d’ailleurs traduit quinze de ses films. Je me souviens d’un film que j’ai aussi aimé traduire, Du Rififi chez les hommes de Jules Dassin, avec qui j’ai travaillé pour le sous-titrage. Quel magnifique argot ! C’était un travail passionnant, car drôle à traduire. En anglais, le film s’intitule Rififi. Lorsque Jules Dassin s’exile en France pour échapper au maccarthysme, il ne comprenait pas un seul mot de français, et encore moins l’argot ! Quand je me mets à travailler avec lui pour la ressortie du film, ça commence mal, car il me déclare ne surtout pas vouloir d’argot dans son film ! C’est là que je réalise qu’il n’avait rien compris de cette langue lorsqu’il avait tourné son film… Je trouve néanmoins un accord avec lui, en lui déclarant que je ne vais pas traduire les phrases argotiques où il n’y a pas d’équivalent en anglais. Un exemple : dans un bar, un gars dit à une hôtesse : « Pose ton gagne-pain là », qui donne, si on traduit le sens, « Put your ass here ». Mais cette phrase en français a aussi son équivalent en anglais, c’est « Put your moneymaker down ». Avec Jules Dassin, ça s’est très bien passé, en fait ; j’ai aimé traduire la chanson qu’interprétait Magali Noël dans le film. C’était d’ailleurs avec l’aide de la fille de Jules Dassin – qui écrivait aussi des chansons pour son frère Joe Dassin – que j’ai fait ce travail autour de la chanson. Il faut savoir que c’était la première fois qu’on la traduisait, car lorsque le film était sorti aux États-Unis en 1955, il n’y avait pas de sous-titrages sur les chansons, on laissait faire tel quel.
Un autre souvenir d’une chanson d’un film français, c’est avec Julien Carette, dans La Grande Illusion de Jean Renoir, qui chante Si tu veux Marguerite. Ce n’était vraiment pas facile à traduire, c’est une chanson du début du siècle assez coquine, qui était très célèbre à l’époque. Je dois ajouter que je suis très heureux lorsqu’il y a une chanson… Pour René Clair, j’ai travaillé sur le film À nous la liberté, il y a beaucoup de chansons, et alors Lenny Borger, tout à sa joie, emporté par le rythme, me fredonne l’air du film…
Nadia, voyez-vous ce qui est par terre là ?
C’est par les chansons françaises que j’ai appris la langue. J’ai gardé tous mes disques vinyle de mon adolescence à Brooklyn. Mes parents étaient des immigrés polonais, ils sont arrivés en 1949 à New York, ils se sont retrouvés dans un camp de déplacés, comme on dit. Ils y sont restés près de trois ans et je suis né à New York en 1951. Mes parents parlaient plusieurs langues : le yiddish, le polonais, l’allemand, le russe, et bien sûr l’anglais américain. À la maison, ils parlaient entre eux polonais et je ne comprenais rien !
Je me souviens d’une revue musicale à Broadway : c’était un spectacle de cabaret fondé sur les chansons de Jacques Brel, qui s’intitule « Jacques Brel is alive and well living in Paris ». Je suis tombé immédiatement amoureux de ses chansons, je passais mes journées à les traduire. Je dois préciser que je n’ai jamais appris la langue française à l’école, ni suivi de cours pour devenir traducteur. J’ai fait un premier voyage en France en 1975, et dès mon retour à New York, je disais à tout le monde que je voulais revenir vivre en France. C’est ce que j’ai fait deux ans et demi plus tard, en 1978. J’étais venu pour écrire ma thèse sur le cinéma de Marcel Pagnol, que je n’ai d’ailleurs jamais terminée. Je me retrouve sans argent à Paris et je réussis tout de même à décrocher un travail rémunéré chez Variety comme critique de cinéma, dans les années 1980. Bon, je dois dire que ce n’était pas une grande époque pour le cinéma français…
C’est en vivant ici que j’ai vraiment appris la langue. Mais ma première rencontre avec le français fut par la chanson. J’étais un jeune Américain, j’avais douze ans et comme on dit : tout commence par des chansons et tout finit par des chansons…
Par Nadia Meflah. Entretien réalisé à Paris, janvier 2020, avec la collaboration de Glenn Myrent.