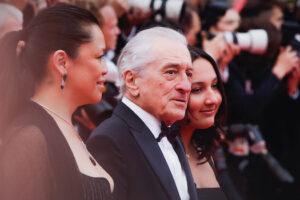Des dames en robe lamée se font photographier chaloupant sur la Croisette à huit heures du matin. Tout est fouillis, soudain.
Relâche, relâche, c’est vite dit. L’avalanche de films du week-end et la giga boule d’images qui s’ensuit ne rentrera pas dans cette chronique, même avec un chausse-pied. Va falloir synthétiser. Soyons brefs sur la maladie mentale et le post-partum d’une femme et mère, dans Die, My Love de Lynne Ramsay. Ces thèmes essentiels illustrés en crises de démence, agressions verbales, attitudes animales et autres gesticulations. Ils résonnent parfois en nous. Mais de montage haché en son décalé, découragent le spectateur et désamorcent l’empathie pour la souffrance étalée sur l’écran. Chère Juliette Binoche, vous qui avez personnifié la douleur et la folie avec nuances et finesse (lire ici notre chant d’amour), pouvez-vous, s’il vous plaît, faire entendre raison à votre jury, si d’aventure il souhaitait récompenser la performance en roue libre de Jennifer Lawrence ?
L’autre film signé par une réalisatrice en compétition samedi, Renoir de Chie Hayakawa (auréolée d’une mention spéciale à la Caméra d’or en 2022 pour Plan 75) n’a pas grand-chose à voir avec le peintre Auguste (le tableau de la petite fille au ruban bleu apparaît fugitivement) ni même avec son fils Jean, l’immense réalisateur de La Règle du jeu. Même si on voit bien la tentation de parler d’un portrait impressionniste qui, en l’occurrence, serait plutôt pointilliste. C’est, en 1987, le parcours (autobiographique) d’une fillette entre sommeil et rêve, fantasme et réel, deuil et renaissance. Les accès morbides, les dangers encourus par l’enfant sont parfois illustrés avec exagération, et la lisière entre le vrai et le faux constamment franchie finit par nous perdre. Mais il y a là une grâce, qui émane surtout de la toute jeune interprète, Yui Suzuki, magique et magistrale.
Ce qui nous amène à sillonner quelques films à hauteur d’enfant avec interprètes confondants. Left-Handed Girl de la Taïwanaise Shih-Ching Tsou (Semaine de la Critique), où la petite Nina Ye, neuf ans, si jeune et déjà star via deux séries télévisées dans son pays, est absolument géniale. The President’s Cake, joli premier long-métrage de l’Irakien Hasan Hadi (Quinzaine des Cinéastes) nous emmène dans les années 1990. Au plus rude de l’autoritarisme de Saddam Hussein et du culte dément de sa personnalité, lorsque l’embargo américain faisait rage et que la population manquait de tout. Une petite fille de neuf ans est tirée au sort dans son école pour cuisiner un gâteau d’anniversaire en l’honneur du président : flanquée de son coq apprivoisé et d’un camarade d’école, elle se met en quête d’ingrédients aussi rares que des œufs et de la farine, coûtant un prix fou. Malgré quelques longueurs, la mise en scène distille à chaque plan l’état du pays, et la jeune Baneen Ahmad Nayyef, fonceuse sans chichis, est d’une obstination qui force le respect. Enfin, à Un Certain Regard, le premier long du Britannico-Nigérian Akinola Davies Jr, My Father’s Shadow, se situe en 1993, à Lagos en période d’espoir démocratique et d’élections présidentielles après de longues années de dictature militaire. Deux petits garçons suivent leur père, d’habitude très absent, de leur village jusqu’à la ville ; perdus dans le dédale bruissant et grouillant, ils croisent des hommes et des femmes inconnus d’eux, militaires, collègues de travail, amis, qui dévoilent peu à peu des pans de la vie de ce papa qu’ils ne connaissent pas. Onirique et tangible, la mise en scène parvient à nous immerger sans quitter le point de vue des gamins. Chibuike Marvellous Egbo et Godwin Egbo sont frères dans la vie et d’une spontanéité émouvante.
Et maintenant, petit intermède en forme de rectificatif : l’ashram me guette, à moins que ce ne soit la folie (vite, vite, trouvez-moi quatre grains d’hellébore !). Ou alors, plus simplement, il faut bien admettre que je ne m’y connais pas très bien en « marques de chien », comme disait Patrick Dewaere dans F. comme Fairbanks de Maurice Dugowson. Quelques lecteurs affligés par mon inculture me font savoir que Bocuse dans Partir un jour n’est pas un labrador, mais un braque. Toutes mes excuses à l’intéressé.
Tandis que Wes Anderson jouait tout seul dans son décor parfait avec ses nombreux copains acteurs prestigieux dans le très fumeux The Phoenician Scheme, est enfin apparu dans la compétition le film total qu’on attendait : L’Agent secret de Kleber Mendonça Filho. Est-ce qu’aimer passionnément toutes les fictions précédentes du réalisateur brésilien – Les Bruits de Recife, 2012 ; Aquarius, 2016 ; Bacurau, 2019 – ainsi que ses documentaires – Critico, 2008 ; Portraits fantômes, 2023 – forme un biais d’appréciation ? Sans doute, mais, dans ce festival comme dans la vie, on n’est pas à l’abri d’une déception. Rien de cela ici, mais une épiphanie. L’Agent secret est foisonnant, drôle, inquiétant, politique, nostalgique, nerveux. On y suit, à Recife, dans le Nordeste du Brésil en 1977, au cours du carnaval et en pleine dictature militaire, le chemin d’un chercheur d’université menacé par le pouvoir qui tente de récupérer son fils et de partir à l’étranger. La corruption sévit dans toutes les arcanes de la société, le racisme et les préjugés de classe font rage et le danger rôde. Le réalisateur tisse un film large, ample, qui emprunte les voies de différents genres (thriller, horrifique) pour dire un monde vicié qui, pourtant, ne parvient pas à saper la beauté de l’amitié, la force de la solidarité. Le pouvoir du lien. Il croque des personnages secondaires savoureux et touchants, telle la propriétaire bavarde comme une pie, ou le grand-père fou de son petit-fils qui travaille dans un cinéma où des spectateurs tombent dans les pommes devant Les Dents de la mer. Dans le rôle principal, Wagner Moura (Elysium, la série Narcos, Civil War) est d’une présence magistrale dès la première scène, grandiose, dans une station-service où git un cadavre en putréfaction (un voleur de fruits abattu froidement) et où il est interrogé et malmené par la police militaire. Jusqu’à la fin, que nous ne dévoilerons pas, située de nos jours et qui dit aussi la transmission et l’attachement aux lieux. Ancien critique et programmateur de salles, Kleber Mendonça Filho croit en l’humain et au cinéma. On le ressent à chaque image.
Après ce week-end surabondant en films, stars, badauds, voitures, détritus (oui, les poubelles aussi débordent) et luxe, on aspire au calme. Voire à la volupté. Ce soir, Julia Ducourneau, Palme d’or pour Titane en 2021, ne nous offrira sans doute rien de tout ça avec son troisième long-métrage en compétition, Alpha. Mais on espère un choc de cinéma.