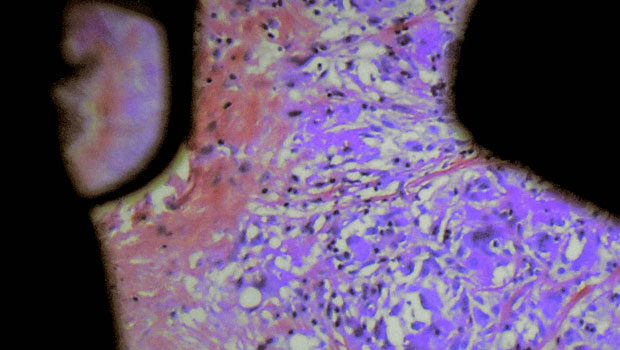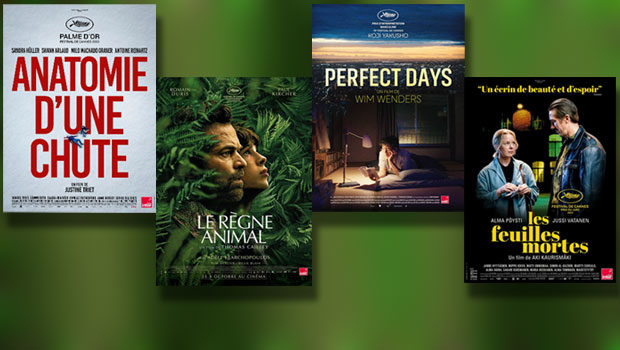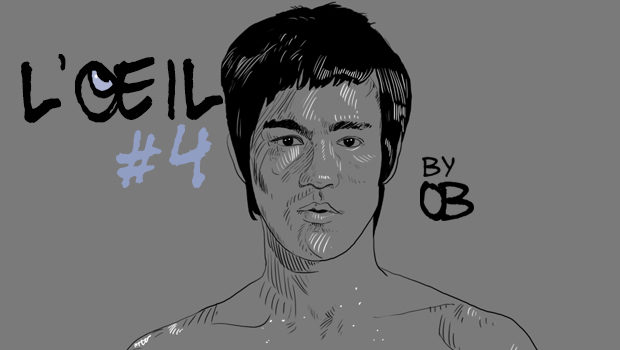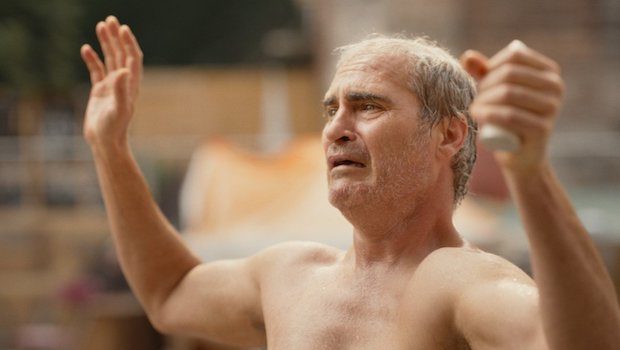John Ford et moi
La cinéphilie est affaire de fétichisme, de partage, d’accumulation, et de chiffres. De décembre à mars, au cœur de l’hiver, dans le secret des salles de la Cinémathèque française, s’est tenu un événement qui, comme les éclipses, n’arrive qu’une fois tous les vingt ans : une intégrale John Ford.
Si quelques prudents spectateurs se sont contentés de picorer les films manquants à leur tableau de chasse dans ce catalogue monumental, d’autres ont préféré abandonner toute vie sociale, s’engager dans un marathon irrationnel, et se fixer la règle de voir et revoir TOUS les films du cinéaste. Je confesse sans honte avoir intégré cette seconde catégorie : 3 mois, 72 films vus sur les 95 programmés, pour un total de plus de 4 jours de projections…
Expérience singulière, autant en raison du nombre de titres que de leur cohérence esthétique et thématique, ou plus encore de leur rareté. Trois mois face à Ford, trois mois hors du temps et de la vie moderne, c’est communier, à raison de trois à cinq séances quotidiennes, avec un public si constant qu’on en vient à reconnaître les nouveaux visages. C’est vivre des émotions décuplées par l’effet de ce compagnonnage, évoluant en chœur, collectivement, au fil de l’avancée de la rétrospective. Jeunes spectateurs et plus âgés auront ainsi partagé la montée progressive d’un enthousiasme enfantin, films après films, comme lors de cette hilarité grondante, hystérique, qui accompagna le final délirant de Steamboat Round the Bend. Ou lorsqu’une salle pleine laissa échapper une exclamation de surprise devant la première apparition de John Wayne dans un film muet de 1928, The Hangman’s House. Avant de sentir, dans les dernières semaines, grandir une tristesse sourde à l’approche de la fin annoncée de ce fragment d’harmonie arraché à l’actualité. Sensation exprimée par des effusions inattendues et rares dans un cinéma, telles ces trois salves spontanées d’applaudissements, à plusieurs minutes d’intervalle, en plein cœur de scènes de plaidoirie dans le lincolnien Judge Priest. Ou ce lourd silence, durant l’ultime week-end, enveloppant la conclusion de l’inégal, mais néanmoins bouleversant The Long Gray Line, idéalement traduit en français par Ce n’est qu’un au revoir.
Car finir une intégrale Ford, c’est être rendu à la vie civile comme ses personnages de militaire en fin de carrière, avec le sentiment du devoir plus ou moins accompli (24 films manqués, tout de même…), et une impression de déracinement d’une mélancolie térébrante. C’est savoir que l’on a profité de cette retraite volontaire de la « vraie vie » pour se réchauffer au doux feu d’images anciennes, et que l’on a grandi intérieurement, en ayant appris à mieux se connaître, après avoir affiné ses goûts, forgé ses souvenirs futurs, ses désirs de partage auprès de gens ne connaissant pas encore cette œuvre à l’aura mythologique, et vouloir vivre pour montrer The Searchers, Wagon Master, ou The Wings of Eagle à des néophytes.
Enfin, avoir traversé une rétrospective Ford du 3 décembre au 1er mars, c’est avoir commencé dans un monde d’avant Charlie, et en être sorti après le 7 janvier. C’est avoir espéré que cette filmographie profondément humaniste et clairvoyante sur la noirceur du monde agisse comme un baume sur notre douleur commune. C’est, passé les premiers jours, avoir continué à se rendre à Bercy, pour trouver une forme de consolation chez le chantre de la résilience face au temps qui passe, aux croyances flétries, aux espoirs asséchés. Chez le réalisateur qui filma toute sa vie mieux que personne la dislocation des communautés, pour mieux glorifier leur survivance dans la mémoire.
Face à l’obscurantisme, tout le monde devrait regarder My Darling Clementine pour se redonner du courage.