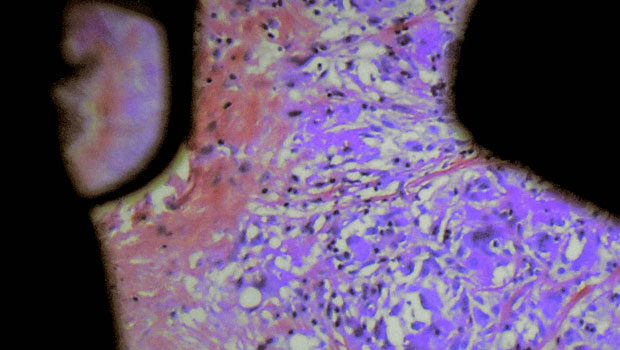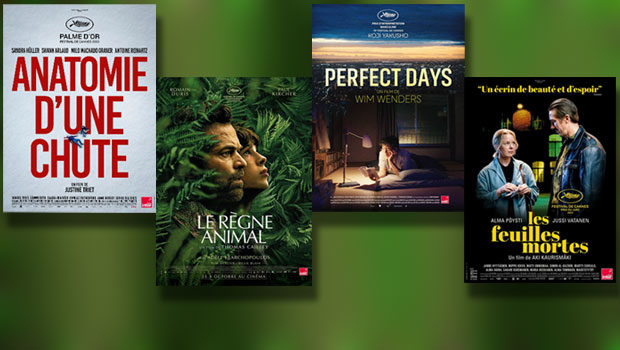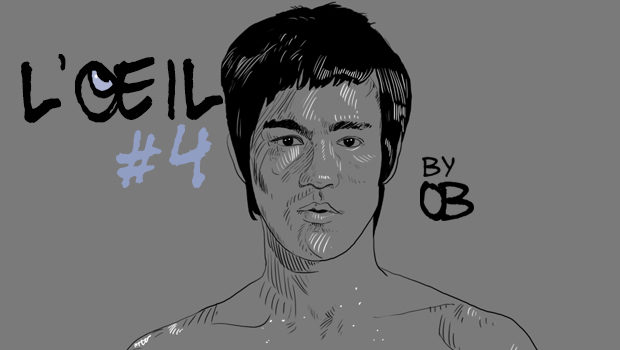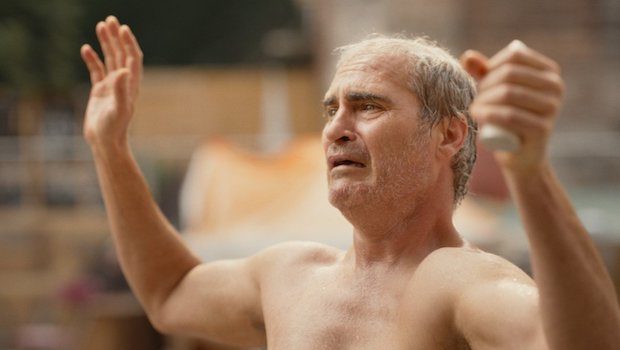Oui, et j’en joue beaucoup : je fais jouer les actrices et acteurs du film à la manière d’une comédie musicale. Je voulais faire un film sur des problématiques actuelles, mais qui s’expriment autant par le chant que la parole. Une des origines du texte du film et des dialogues vient d’une ancienne chanson turque. Une histoire d’amour, dont j’ai fait une histoire du monde : « ma fille, je te donne ce Monde, prends-le, chérie-le », et elle répond : « non, je ne veux pas de ce monde, il est cruel ». « Mais non, rappelle son père, ce monde est beau quand on sait comment le prendre ». Donc voilà : Djam est une comédie musicale, parce que j’avais envie de prendre ce texte et la musique de cette vieille chanson comme point de départ pour mon film. Et puis il y a aussi Aman Doktor, une vieille chanson turco-grecque que je connaissais bien et qui m’a inspiré. Et d’autres, que j’ai découvertes pendant l’écriture. Enfin, j’avais envie de parler de l’exil des Grecs par le Rebetiko, une musique populaire grecque que j’aime beaucoup et dont les musiciens semblent refuser les malheurs du monde. Car ces Grecs, qu’on voit dans le film, venaient à l’origine de Turquie, où ils ont été chassés dans les années 1920 par Atatürk. Ils sont arrivés en Grèce avec le Rebetiko dans leurs bagages.
Depuis longtemps, j’avais dans la tête Guernica, de Picasso. Parce qu’avec Guernica, Picasso fait une fresque, où il raconte toute l’histoire du bombardement de Guernica, de la Guerre d’Espagne, mais à travers un mélange fou de styles différents. Et c’est un peu cette idée que j’avais : faire appel à des styles différents pour parler d’une même chose : la guerre, le malheur qui nous frappe tous. Je ne pouvais pas faire ce film de manière réaliste, avec une narration simple. Il y avait trop de choses à dire. J’ai commencé d’abord à écrire l’histoire de Djam : une femme libre dans un monde insupportable.
Au bout de six mois d’écriture, j’avais déjà fait plusieurs versions du scénario, quand il y a eu cette attaque, dans le 11e, mon quartier, des jeunes qui ont tué d’autres jeunes. Et pour des raisons stupides que je ne connais pas, et qu’eux non plus ne connaissent pas. Et puis le Bataclan. J’ai mes habitudes au bar du Bataclan, je connais très bien. Et ça m’a donné la nausée pendant des mois et des mois. Je ne pouvais plus laisser l’histoire de Djam comme elle était après ces évènements. Mais je n’avais plus envie d’écrire, et surtout pas d’écrire là-dessus. Mon envie, c’était de parler de l’exil des Grecs, entre la Turquie et la Grèce. Mais sur cette mer de huit kilomètres qui sépare la Turquie de la Grèce, j’ai vu partout le peuple syrien, arabe, musulman, qui est parti à travers ces routes et cette mer. Des milliers de « migrants » qu’on voyait en direct sur tout Internet et sur toutes les télés du monde. Et je ne comprenais pas comment j’allais faire pour en parler : ce sont des migrations bibliques, un nombre énorme de personnes, des flux migratoires comme j’avais pu en voir en Algérie, avec l’exil des Pieds-Noirs. Pour moi, ces attentats, cette crise migratoire, c’était des pièges : c’est évidemment important d’en parler, mais comment en parler ? Qu’est-ce que peut faire le cinéma là-dedans ? On ne pouvait rien faire. Des massacres, dans mon quartier ! Je ne pouvais rien faire. À part dire qu’« on n’a pas peur », comme l’ont fait les jeunes à ce moment-là. Mais le cinéma ne pouvait pas toucher cette histoire, comme il ne pouvait pas toucher l’histoire des migrants. Ou sinon, on est tout de suite vulgaire.
Oui, parce que suite à ces évènements, j’étais en échec face à la narration. J’imaginais mal dans mon histoire mettre un bateau pneumatique et trois ou quatre figurants syriens avec un machiniste qui les pousse. Ce n’était pas possible. Je voulais éviter la vulgarité et l’émotion forcée, fabriquée. Ce qui m’est venu en aide à ce moment-là, ce sont les traces de tous ces gens. Parce que des milliers et des milliers de personnes qui passent sur une route, ça laisse des traces. Aujourd’hui, il y en a peut-être moins. Mais quand j’étais là-bas, faire les repérages, c’est les traces que j’ai vues. Les traces sont plus fortes que les gens. Il fallait parler d’eux, mais sans montrer les camps ou les tentes blanches de l’ONU qu’on a pourtant vues sur place. Mais ces traces, celles qu’on voit dans le film, on les a laissés telles qu’elles. Les écritures au charbon sur les murs, les traverses de chemin de fer brulées pour faire chauffer du thé, c’est ce qu’on a vu en arrivant. Et il y a d’autres choses que j’ai vues, mais que je n’ai pas voulu mettre dans le film. Parce que c’était trop vulgaire. J’ai vu le carnet scolaire d’un enfant de huit, neuf ans, trainer sur les rails. J’imagine que ce gamin est parti de chez lui en se disant qu’il amènerait aussi son carnet scolaire pour montrer à ces Européens qu’il était plutôt bon élève. Il l’a perdu sur le chemin, dans des circonstances inconnues. Je n’aurais pas pu mettre ça dans le film, ça aurait fait trop voulu, trop fabriqué.
Avril est un personnage très énigmatique. Il faut, je pense, dans tout film au moins un personnage mystérieux. Le fait qu’un personnage soit couvert de mystère, ça invite le spectateur à penser autour de ce personnage. À l’origine, Avril est venue à Istanbul pour rejoindre Raqqa. Mais elle n’en parle jamais. Elle dit qu’elle habite « la banlieue », comme si la banlieue était un pays, une province. Mais la banlieue, c’est rien. Ça a poussé, comme ça, d’un coup, à Chanteloup-les-Vignes, ou derrière les usines Simca, à côté de Poissy, ou ailleurs. Il n’y a pas de « banlieue » universelle. C’est bien d’être fier de là d’où on vient, mais chaque banlieue à son histoire. Avril vient de Châtenay-Malabry, qui a une histoire particulière, un patrimoine propre. Mais Avril ne le connaît pas, parce qu’elle n’a pas de culture – et je le dis sans méchanceté. Contrairement à Djam, qui elle regorge de culture. Et Avril souffre de se comparer à Djam et sa richesse culturelle…
Ça s’est fait beaucoup aussi avec la culture des personnages, et des acteurs. Prenez l’oncle par exemple : c’est Simon Abkarian, qui a une classe énorme. Et lui aussi, c’est un exilé. Un exilé éternel, puisqu’il a plusieurs exils… Et tous les deux, on partage cet exil d’être exilés de partout. Et ces exils se ressentent aussi sur son langage : il parle arménien, arabe, turc, grec et français. C’est un peu comme un Tzigane…
Oui, mais ça, c’est autre chose : c’est le nouveau monde. Aujourd’hui, les jeunes parlent plusieurs langues, parce qu’ils ont appris beaucoup, parce qu’ils ont voyagé.
Toutes ces musiques et ces danses, c’est une façon d’être ensemble. Ce n’est que ça, et c’est très beau. La danse orientale n’est pas une danse méprisante pour la femme. Ce n’est pas du tout la « danse des légionnaires » qu’on peut voir dans des cabarets dans certains vieux films. La danse, la musique et le cinéma ont la même fonction : amener les gens à être ensemble.
C’est Thierry Frémaux qui est à l’origine de l’idée. J’avais vu des films à ce cinéma de la plage, et je trouvais le dispositif pas mal. Il faut savoir que Djam, personne ne l’avait vu venir. On a terminé le film en mai, et tout de suite il a été projeté pour Thierry Frémaux, c’est un des derniers films qu’il a dû voir. Il nous a proposé de le montrer au cinéma de la plage, en rajoutant un concert de mes musiciens, ceux du film, une vingtaine. C’était une belle idée, ça a très bien marché, au moins 1.500 personnes sont venues. On était content, pour Frémaux, le cinéma de la plage, c’est vraiment une nouvelle salle pour le festival. Et personne n’est parti ! Alors qu’à Cannes, il y a toujours plusieurs personnes qui quittent la salle… [rires]
Oui, c’est du 1 :50, un format idéal pour les gros plans. Et c’est un film de gros plans. Donc un film humain, avant tout. Comme Renoir ou Jean Vigo, j’ai envie d’être près des gens.
Oui, j’avais envie d’avoir le point de vue du muezzin, qui lance l’appel à la prière. Parce que c’est ce son, qu’on entend dans tout Istanbul, qui fait ce c’est Istanbul. C’est un truc incroyable, unique. Ce qui dépayse, c’est ça, c’est appel à la prière, magique, qui sort de partout. C’est pour ça qu’il fallait une séquence sur les toits d’Istanbul, où on est au milieu de ça, au milieu des minarets.
Tout ce que je voulais fuir dans ce film, c’était le fabriqué, l’artificiel. Pas d’émotions fabriquées, et donc pas d’images fabriquées.